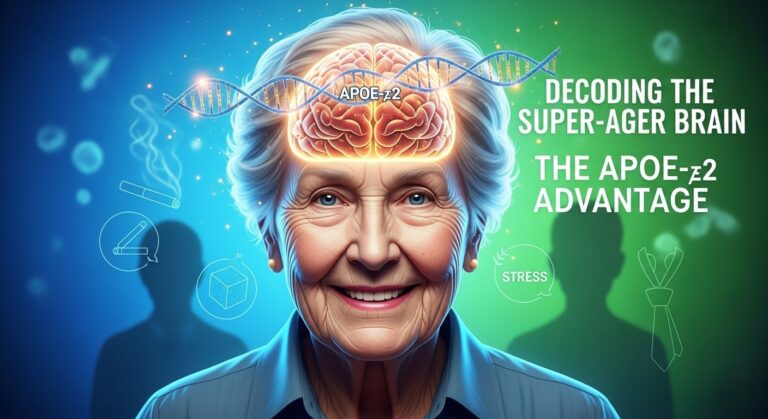Surpoids : Un Atout Inattendu pour la Santé ?
Et si tout ce qu’on vous a dit sur le poids idéal était à revoir ? Une étude danoise récente, présentée lors d’une conférence européenne, secoue les certitudes : être légèrement en surpoids pourrait, dans certains cas, être plus protecteur que d’être mince. Ce constat, surprenant à première vue, nous invite à repenser notre rapport au corps, à la santé et aux normes établies. Partons à la découverte de ces révélations, qui pourraient changer la façon dont nous percevons le BMI et la santé globale.
Quand le Surpoids Devient un Atout
Depuis des décennies, la minceur est glorifiée comme le symbole ultime de la santé. Les campagnes de prévention, les régimes à la mode et les standards esthétiques nous martèlent qu’un corps svelte est synonyme de vitalité. Pourtant, une équipe de chercheurs danois, menée par Sigrid Bjerge Gribsholt de l’hôpital universitaire d’Aarhus, remet en question cette idée. Leur étude, basée sur les données de plus de 85 000 adultes, révèle que les personnes en léger surpoids, voire en obésité modérée, ne présentent pas un risque de mortalité plus élevé que celles dans la tranche dite « normale » du BMI.
Plus surprenant encore, les individus ayant un BMI inférieur à 18,5 (catégorie sous-poids) ou même dans la moitié inférieure de la plage « saine » (18,5 à 22,5) affichent un risque de décès significativement plus élevé. Ces résultats, ajustés pour des facteurs comme le sexe, les comorbidités et le niveau d’éducation, dessinent une courbe en U : les extrêmes, qu’il s’agisse de maigreur ou d’obésité sévère, sont associés à des risques accrus, tandis que le centre, incluant le surpoids, semble être une zone de sécurité.
Le BMI : Une Mesure à Nuancer
Le Body Mass Index, ou indice de masse corporelle, est un outil universellement utilisé pour évaluer si une personne est à un poids « sain ». Calculé en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille (en mètres), il classe les individus en catégories : sous-poids (<18,5), normal (18,5-25), surpoids (25-30) et obésité (>30). Mais ce système, bien que simple, a ses limites. Il ne distingue pas la masse musculaire de la graisse, ni la répartition de cette dernière, un facteur clé pour la santé.
« Le BMI n’est pas le seul indicateur de santé. La répartition des graisses compte autant, voire plus, que leur quantité. »
– Jens Meldgaard Bruun, co-auteur de l’étude
Les chercheurs soulignent que la graisse viscérale, celle qui s’accumule autour des organes internes, est bien plus problématique que la graisse sous-cutanée, stockée sous la peau. Une personne avec un BMI de 35, mais avec une répartition « poire » (graisse sur les hanches et les cuisses), peut être en meilleure santé qu’une autre, au même BMI, mais avec une silhouette « pomme » (graisse abdominale).
Pourquoi la Maigreur Peut-Elle Être Dangereuse ?
Si le surpoids modéré semble offrir une forme de protection, la maigreur, elle, peut être un signal d’alarme. En cas de maladie grave, comme un cancer ou une infection, le corps entre en état catabolique. Il puise alors dans ses réserves – muscles, graisses, voire organes – pour maintenir ses fonctions vitales, notamment le cerveau. Une personne trop maigre dispose de moins de réserves, ce qui peut compliquer la récupération.
De plus, un faible BMI peut masquer des problèmes sous-jacents. Une perte de poids soudaine, souvent perçue comme positive, peut être le symptôme de pathologies comme le diabète de type 1 ou certains cancers. Les chercheurs danois notent également que la malnutrition, même légère, affaiblit le système immunitaire et augmente la vulnérabilité aux infections.
Une Courbe en U : Les Données Parlent
L’étude danoise a analysé les données de 85 761 adultes, avec un âge médian de 66,4 ans. Parmi eux, 8 % sont décédés durant la période de suivi de cinq ans. Voici les principaux résultats :
- Les personnes en sous-poids (BMI <18,5) avaient un risque de décès près de trois fois plus élevé que le groupe de référence.
- Celles avec un BMI de 18,5 à 20,0 présentaient un risque doublé.
- Les individus dans la plage 20,0-22,5 avaient un risque accru de 27 %.
- Les personnes en surpoids (25-30) ou en obésité modérée (30-35) n’avaient pas de risque accru.
- Seule l’obésité sévère (BMI ≥40) augmentait le risque de décès de 23 %.
Ces chiffres, bien que frappants, doivent être interprétés avec prudence. La population étudiée, composée majoritairement de personnes suivies pour des examens médicaux, pourrait inclure des individus déjà atteints de maladies, ce qui peut biaiser les résultats. Ce phénomène, appelé reverse causation, suggère que la maigreur pourrait être la conséquence d’une maladie sous-jacente, et non la cause directe du décès.
Repenser l’Obésité : Une Approche Personnalisée
Cette étude ne donne pas un blanc-seing à l’obésité. Les chercheurs rappellent que l’excès de poids, surtout lorsqu’il s’accompagne de graisse viscérale, reste lié à des maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Cependant, elle met en lumière l’importance d’une approche individualisée. Plutôt que de se focaliser uniquement sur le BMI, il faut considérer :
- La répartition des graisses : abdominale ou périphérique ?
- La composition corporelle : muscle ou graisse ?
- Les marqueurs métaboliques : glycémie, pression artérielle, cholestérol.
- L’âge : les seniors bénéficient souvent de réserves supplémentaires.
Une étude récente de la Global Commission on Clinical Obesity va dans le même sens, proposant un nouveau cadre diagnostique qui intègre ces facteurs. De même, des chercheurs de Harvard suggèrent que le pourcentage de graisse corporelle et sa localisation sont de meilleurs prédicteurs des maladies cardiovasculaires que le BMI seul.
Les Implications pour la Santé Publique
Ces découvertes pourraient transformer les politiques de santé publique. Plutôt que de promouvoir un poids idéal universel, les campagnes pourraient encourager une approche personnalisée, tenant compte de la santé métabolique et des besoins spécifiques de chaque individu. Cela pourrait également réduire la stigmatisation associée au surpoids, souvent perçu comme un échec personnel plutôt qu’une question complexe de biologie et d’environnement.
« L’obésité et la maigreur sont des défis mondiaux. Nous devons dépasser les chiffres bruts pour comprendre leur impact réel. »
– Sigrid Bjerge Gribsholt, chercheuse principale
En parallèle, ces résultats soulignent l’importance de la prévention de la malnutrition, notamment chez les personnes âgées. Un régime trop restrictif, souvent adopté pour atteindre un idéal de minceur, peut entraîner des carences et affaiblir le système immunitaire, surtout en période de stress physiologique.
Un Changement de Paradigme
Le concept de fat but fit – être en surpoids mais en bonne santé – gagne du terrain. Cette étude danoise, bien que non dénuée de limites, nous pousse à réfléchir. Et si la santé ne se résumait pas à un chiffre sur une balance ? En tenant compte de la répartition des graisses, de la composition corporelle et des marqueurs métaboliques, nous pourrions mieux accompagner les individus vers une santé durable.
Alors, la prochaine fois que vous montez sur la balance, rappelez-vous : un peu de réserve énergétique n’est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui compte, c’est d’écouter son corps, de surveiller sa santé globale et de ne pas se laisser enfermer dans des normes rigides. La science, elle, continue d’évoluer, et nous avec elle.